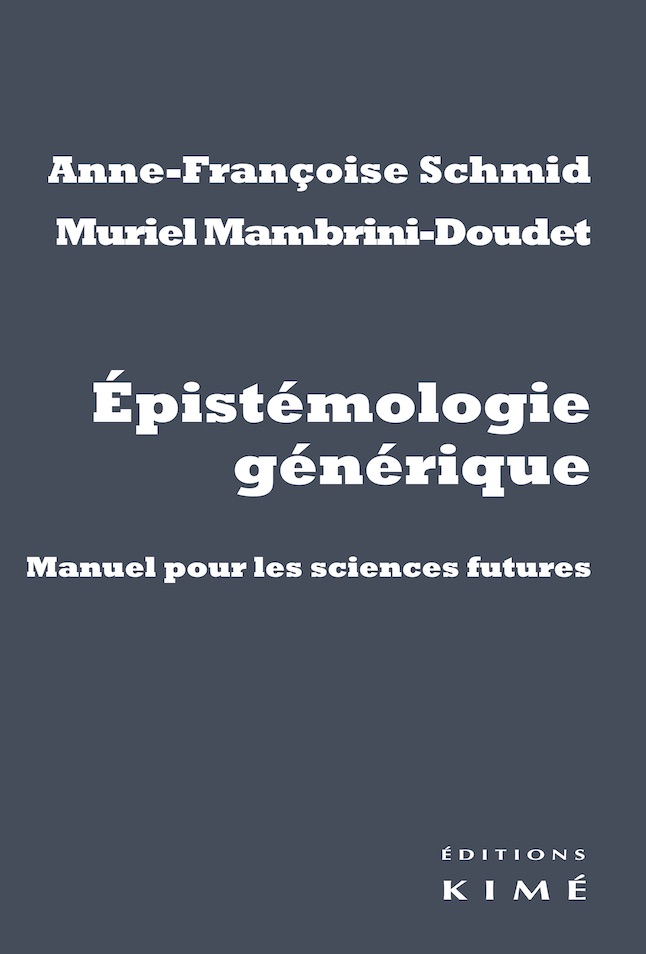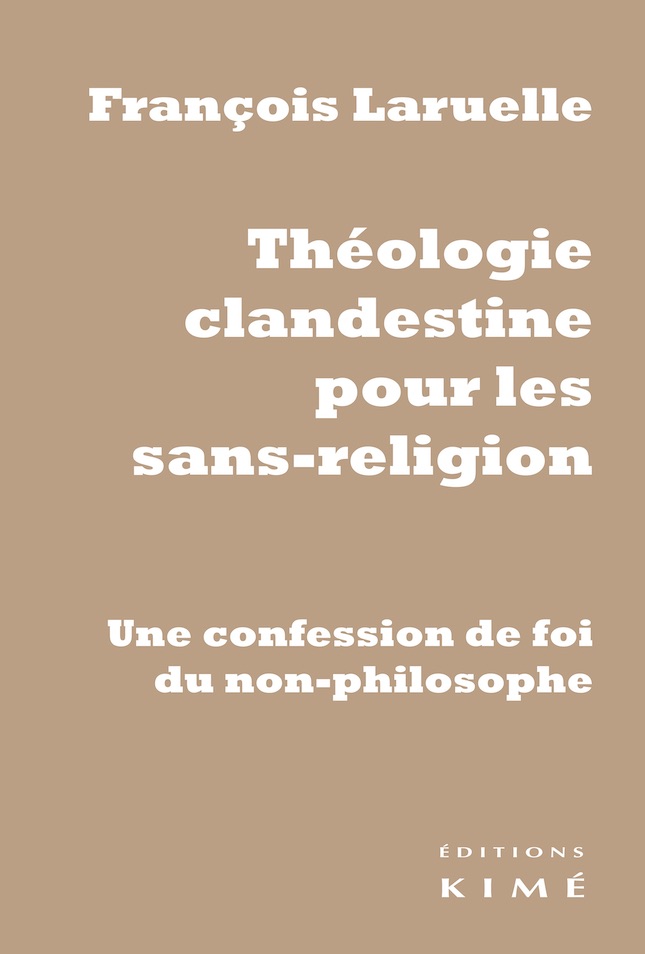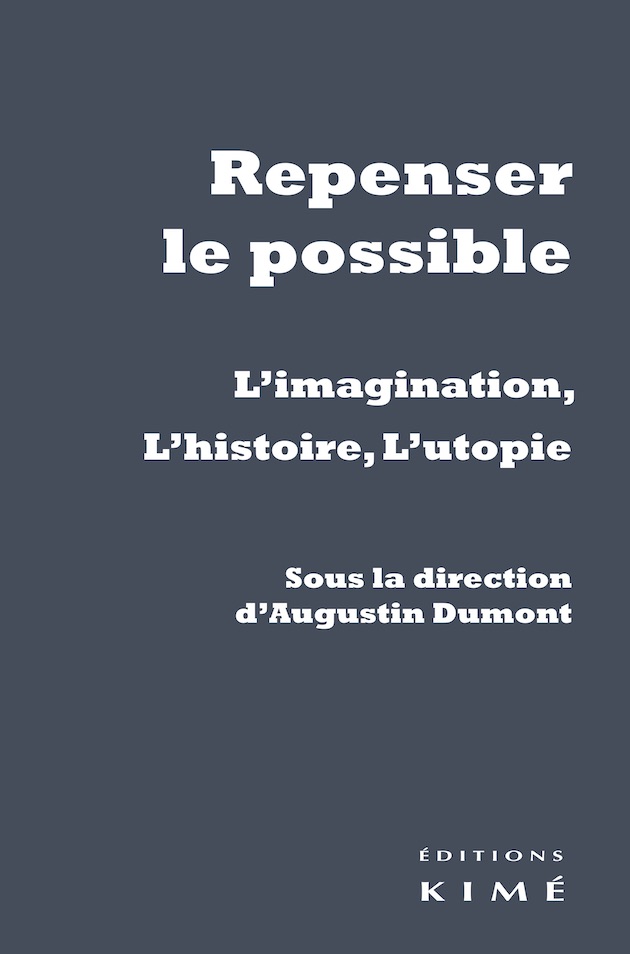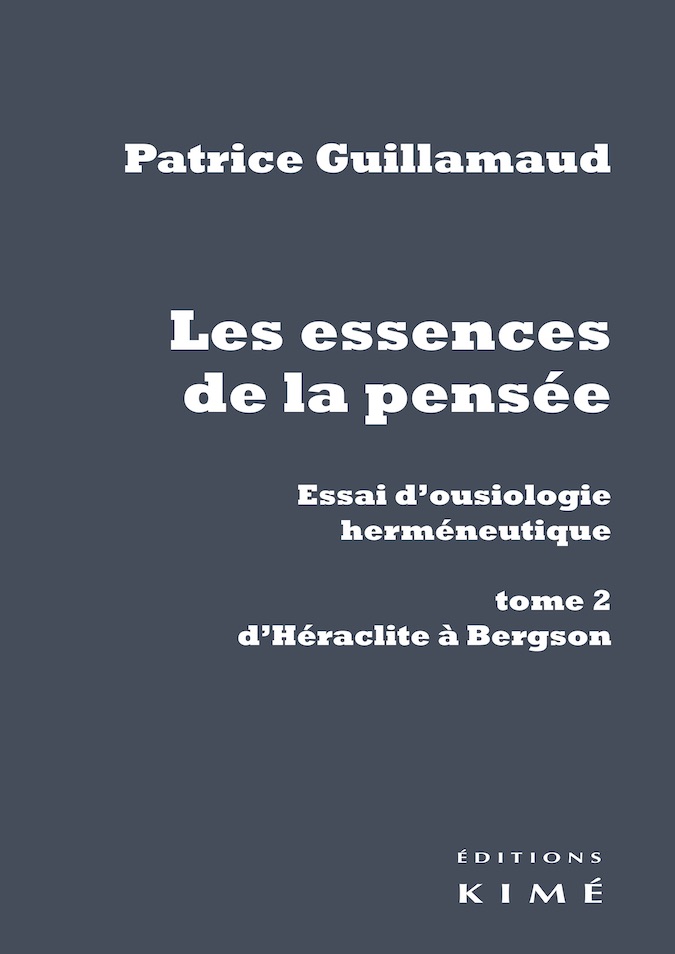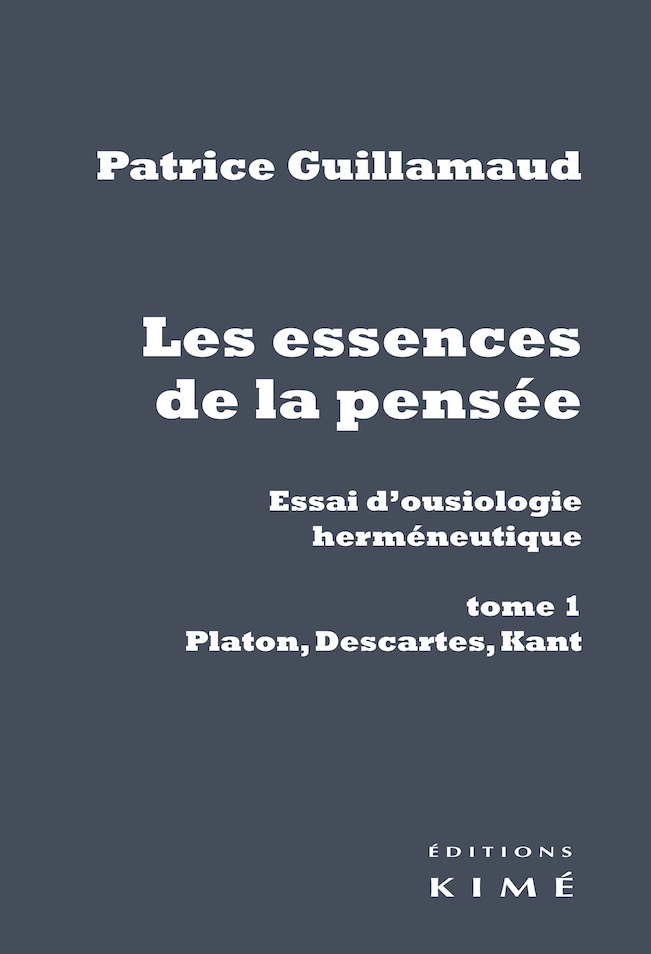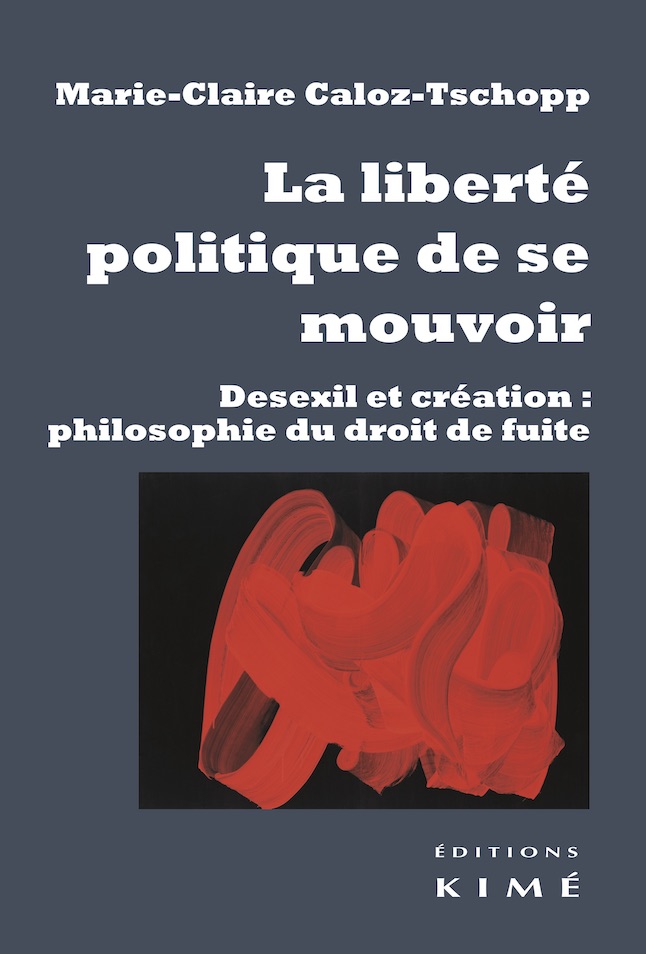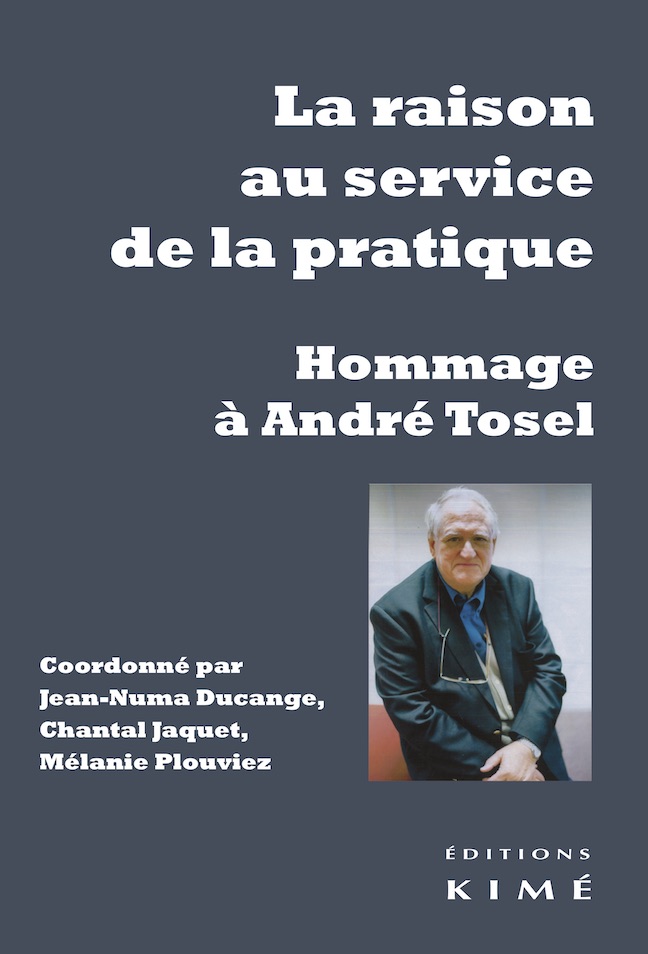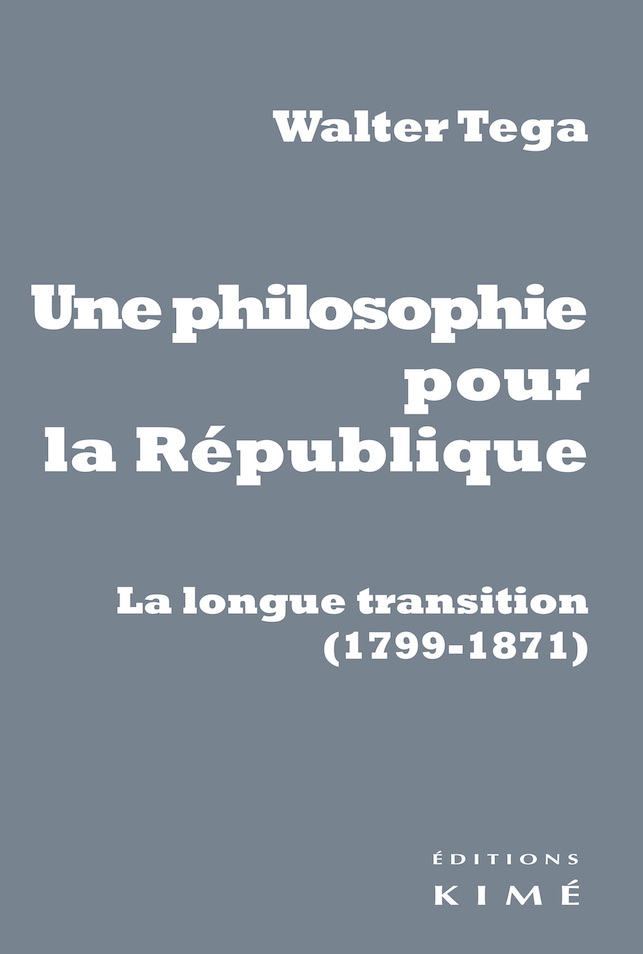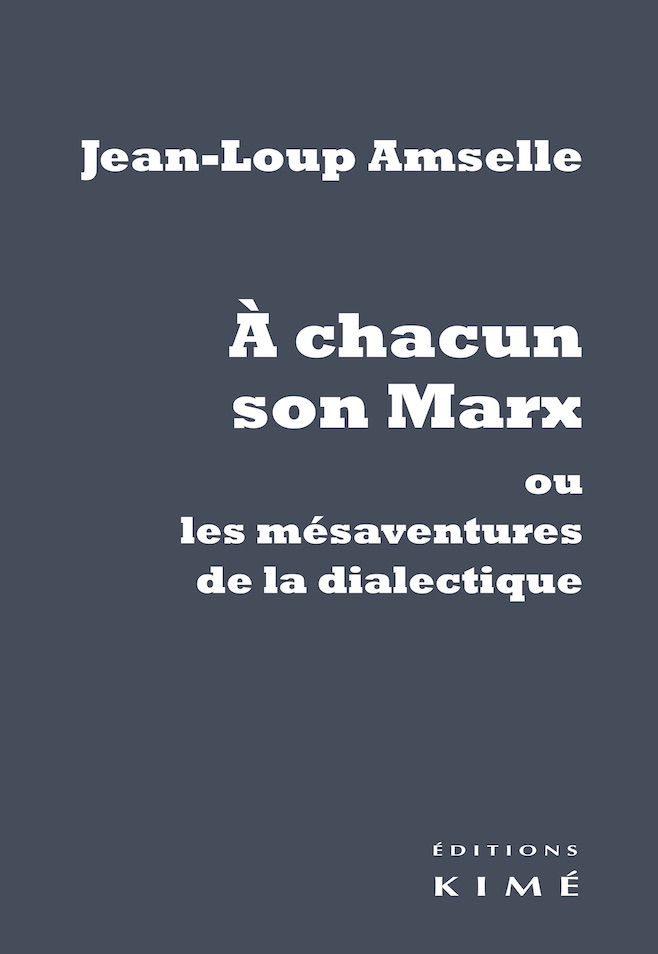Ce livre donne à voir ce qui fait « science » en dehors des organisations disciplinaires. Notre capacité à caractériser ce qui est produit en dehors des disciplines académiques est limitée. Les initiatives interdisciplinaires se multiplient mais restent difficiles à transmettre tant elles reposent sur l’ « intuition » des instigateurs et la somme de « petits riens » qui se placent mal dans le cadre épistémologique classique. C’est l’extension…
Conflits, Pratiques, Horizons Coordonné par Mélanie Duclos et Anders Fjeld Renforcement tendanciel des autoritarismes d’État, globalisation économique et transformation des institutions de recherche, judiciarisation de la recherche et des chercheurs, climats de censure sur fond d’inégalités sociales et de conflits socio-politiques, à ces tendances transversales répondent en écho les alternatives et les résistances des chercheurs qui, de par le monde, s’y opposent et cherchent, pratiquent et proposent d’autres manières de…
Une confession de foi du non-philosophe Il n’y aura pas de retour du Christ, la guerre des religions continue. Après tant de philosophies réduites au débat du grec et du juif, de Platon et de Levinas, quelle place reconnaître au christianisme, gnose comprise, et comment l’arracher au dernier fond religieux et philosophique dont il a tenté de libérer les sujets humains? Après tant d’appels au meurtre de Dieu, à la…
L’imagination, l’histoire, l’utopie Introduite par Thomas More en 1516, la notion d’utopie a rapidement pénétré le champ de la littérature et de la philosophie. La double apparition de la problématique de l’utopie dans l’univers de la fiction et dans celui de la réflexion philosophique n’a toutefois été accompagnée d’aucune promotion à proprement parler. En effet, la référence à l’utopie a suscité, de la part des philosophes modernes et contemporains, davantage…
ESSAI D’OUSIOLOGIE HERMENEUTIQUE TOME 2 : d’Héraclite à Bergson Ce livre est une psychanalyse essentielle et rigoureuse de la philosophie. L’histoire de la philosophie s’y annonce comme étant l’incarnation diversifiée de trois essences fondamentales de la pensée de l’être ou de trois ontologies. Ces ontologies sont aussi les trois moments de la vie renonciatrice de la pensée. La pensée aspire à l’absolu et relativise cette aspiration tout en s’accomplissant dans…
ESSAI D’OUSIOLOGIE HERMENEUTIQUE TOME 1 : Platon, Descartes, Kant Ce livre est une psychanalyse essentielle et rigoureuse de la philosophie. L’histoire de la philosophie s’y annonce comme étant l’incarnation diversifiée de trois essences fondamentales de la pensée de l’être ou de trois ontologies. Ces ontologies sont aussi les trois moments de la vie renonciatrice de la pensée. La pensée aspire à l’absolu et relativise cette aspiration tout en s’accomplissant dans…
L’essai philosophique part de la migration, des réfugiés, découvre la liberté politique de se mouvoir, revisite l’exil (domination), le desexil (lutte créatrice) et propose une philosophie du droit de fuite. L’essai philosophique est une démarche sur des embarras, apories, énigmes de mensonges politiques, de la liberté politique (Arendt, Douglass) de la révolution (Luxemburg), des lignes de fuite (Guattari), du droit de fuite (Mezzadra), de la ruse (métis d’Ulysse, Pénélope), de…
André Tosel (1941- 2017) était un philosophe engagé, qui, durant toute sa vie, a mis sa raison au service d’une pratique de transformation du monde. Spinoziste de la première heure et marxiste critique, il a marqué la pensée politique pendant près d’un demi-siècle et il a été également un remarquable passeur de la philosophie italienne en France, comme en témoignent ses études magistrales sur Vico, Gramsci, Labriola. Tenant lucide d’un…
ISBN: 978-2-84174-927-0
Nombre de pages: 306
Auteur: DUCANGE Jean-Numa, JAQUET Chantal, PLOUVIEZ Mélanie
Année: 2019
Walter Tega est connu pour ses travaux sur l’idée d’Encyclopédie dans la culture européenne. Il a toujours insisté sur les liens que cette idée entretient avec les combats politiques fondateurs de l’idée républicaine. Dans cet ouvrage, Walter Tega retrace l’histoire du socialisme français dans ses liens avec une exigence de culture scientifique, critique et démocratique à la base du combat républicain. Cet ouvrage vient ainsi combler un manque dans la…
Ce livre est une autobiographie intellectuelle du rapport mouvementé et inconstant de l’auteur au marxisme ainsi qu’à un événement qu’il n’a pas vécu, Mai 1968. Il s’agit d’un ouvrage de souvenirs, agrémenté de réflexions plus contemporaines issues de son métier d’anthropologue. L’idée générale qui y est développée est que la pensée de Marx appartient à tous ceux qui s’en réclament. Source d’inspiration et d’émancipation pour comprendre les impasses de la…