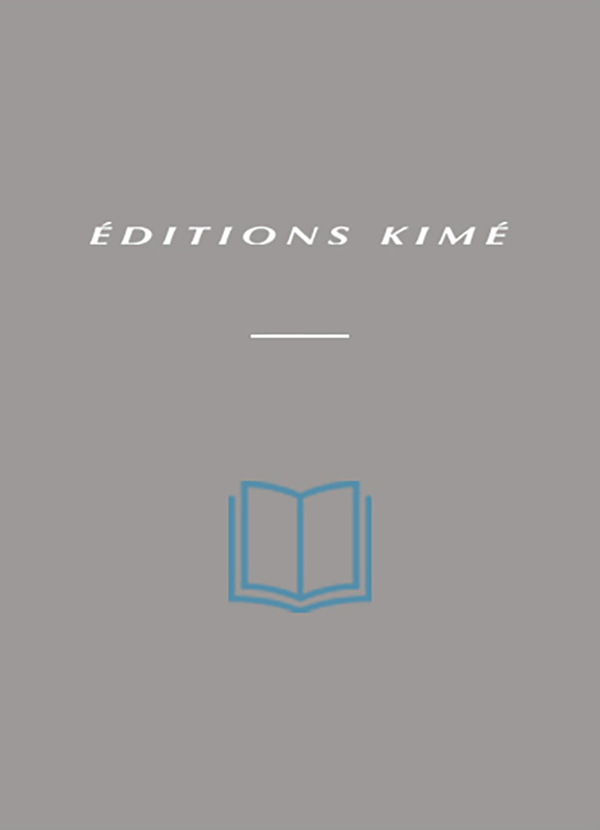Comment expliquer l’appel de mort lancé par Khomeiny le 14 février 1989 contre Salman Rushdie? Quelles sont les vraies raisons de cet acte? Partant du constat qu’elles ne sauraient être trouvées dans le roman de Rushdie, l’auteur les recherche dans la vision religieuse de Khomeiny, sa théologie politique, … L’image que nous avons de cette affaire se trouve ainsi radicalement remise en cause. Ramine Kamrane est chercheur au Centre d’Histoire…
Lorsqu’en 1962 Norbert Elias atteint l’âge de la retraite, il ne prend pas congé pour autant de la sociologie. Il commence une nouvelle carrière en acceptant pour deux ans un poste de professeur de sociologie à l’Université du Ghana à Legon. Au Ghana Elias manifeste un vif intérêt pour l’art africain. A son retour en Angleterre il emporte avec lui une vaste collection de pièces de différentes régions d’Afrique. Désormais,…
Qui a voulu la guerre? Est de la propagande nationaliste, certes, mais “scientifique”. Il faut distinguer les causes impersonnelles de la guerre des volontés humaines. Est ici résumée et vulgarisée une phrase de la théorie durkheimienne qui sépare la “société” des “individus”. Cette théorie, qui a mal vieilli, est l’épine dorsale de ses recherches. Emile Durkheim et Ernest Denis. Préface de Michel Dion.
Les visages de la criminalité : à la recherche d’une théorie scientifique du criminel type
En savoir plusDès le XIXe siècle, les chercheurs ont rêvé de repérer scientifiquement les criminels, de définir la criminalité et ses causes. Leur problématique reste d’actualité : quels sont les visages de la criminalité ? Le débat sur les causes de la criminalité qui fit rage de 1860 à 1914 en Grande-Bretagne, fut à l’origine d’une nouvelle science, la Criminologie. Les criminologues, issus pour l’essentiel des milieux médicaux (médecins, psychiatres) et administratifs…
La démocratie a-t-elle un avenir dans l’Etat de droit ? Ce livre se veut une référence à l’usage de tous ceux qui veulent comprendre les enjeux d’une évolution majeure de notre démocratie : la construction d’un Etat de droit. Ce dernier risque d’être le fossoyeur de la démocratie. C’est la thèse que développe l’auteur. Ce qui est en jeu avec la construction de l’Union Européenne, ce n’est ni plus ni…
L’organisation politique souhaitable pour l’Europe apparaît clairement comme l’enjeu majeur de cette fin de XXe siècle. La question centrale envisagée ici est celle de la compatibilité entre la théorie fédéraliste et son application dans une organisation politique. Puisque l’Europe ne peut devenir une réalité vivante que si les Européens se sentent concernés, cet ouvrage veut offrir au lecteur les outils nécessaires à sa réflexion.
L’émigration n’est pas seulement une voie de salut pour les démunis de ce monde, c’est aussi une malédiction : devenir immigré, c’est devenir paria. La malédiction ne se mesure pas seulement dans la vie, les mots, la déchéance, mais aussi dans les débats culturels, sociaux, politiques, … On n’y peut rien, nous dit-on. La société est ainsi faite. Certes, mais on peut aussi s’insurger ; avec des armes intellectuelles. C’est…
Citoyenneté et construction des genres aux XIXe et XXe siècles En interrogeant les fondements même de la société bourgeoise le thème de ce livre exprime la volonté de sortir d’une pratique par trop réductrice connue sous le nom d'”histoire des femmes”. Cette approche tente de relier l’histoire des femmes aux discours politiques ou littéraires, à l’histoire sociale et à l’économie. Sous la direction de Hans-Ulrich Jost, Monique Pavillon, François Vallotton.
La représentation politique au Journal télévisé. Cet ouvrage est une étude de la campagne présidentielle de 1988 à la télévision. Délaissant les lieux traditionnellement consacrés, la politique se décline en effet plus que jamais sur un mode télévisuel. Ce changement implique une redéfinition de la notion de “représentation” politique. Cette étude analyse l’image des candidats à l’élection présidentielle, et répond à de multiples interrogations. Ancienne élève de l’ENS, agrégée de…
Préface de Daniel Soulez Larivière. A l’instar des juges, les avocats parlent, se racontent, dévoilent les dessous de leurs dossiers. Aujourd’hui, ils ne se contentent plus de se prêter au jeu des médias, ils les sollicitent, au mépris parfois des règles déontologiques de leur profession. Ici et là, des voix s’élèvent pour réclamer un réaménagement du secret. Aujourd’hui, tout procès d’importance se joue aussi à l’extérieur des prétoires. Journaliste à…