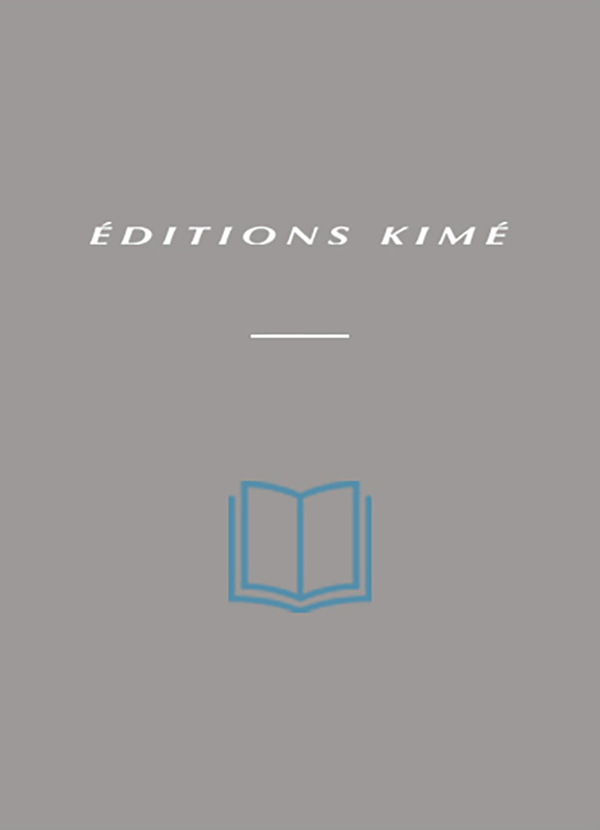L’ironie socratique est une technique oratoire qui vise à la fois à railler et à instruire. Pour les rhétoriciens, l’ironie verbale est par ailleurs un simple artifice stylistique consistant à exprimer une pensée à l’aide de mots contraires, à signifier l’opposé de ce que l’on cherche à faire entendre. Laurent Perrin fait le point sur différentes approches, anciennes et récentes, des tropes et de l’ironie. Cette étude propose une analyse…
Cet ouvrage est un recueil d’essais consacrés aux traces langagières que laisse le locuteur dans ces énoncés. Il permet de montrer comment divers phénomènes qui relèvent du niveau de la langue marquent et restreignent l’activité énonciative. L’approche est modulaire, et prend son départ dans l’ancrage formel des aspects du sens qui dévoilent la présence du locuteur, pour montrer ensuite comment la forme linguistique pose des contraintes précises sur l’interprétation de…
Partant des approches classiques de la sémantique et de la pragmatique du temps dans la langue, en référence aux travaux de Beauzée, Reichenbach, Damourette et Pichon, Guillaume, Benvéniste et Weinrich, l’ouvrage propose une présentation synthétique des approches récentes du temps et de l’aspect en sémantique du discours. Il apporte des contributions originales aux questions traditionnelles liées au temps : référence temporelle, description des temps verbaux et de l’aspect, connecteurs temporels,…
Comment définir le circonstanciel? La solution que l’on croit avoir découvert se délite dès qu’on élargit le champ des données. Que faire pour apprivoiser le rebelle? Prenant le parti de l’efficacité empirique, on commencera par décrire des classes de circonstanciels à partir d’un corpus d’exemples forgés ou attestés. La méthodologie consiste à construire l’identité du complément en fonction de ses contraintes distributionnelles et syntaxiques dont on infère ses propriétés sémantiques.…
Visant la résolution argumentée des conflits d’opinions, La Nouvelle Dialectique propose un système de règles normatives pour la discussion critique. La Nouvelle Dialectique n’est pas une réthorique, en ce qu’elle fonde un traitement rationnel du conflit d’opinion. Elle n’est pas une logique, en ce qu’elle prend appui sur les échanges argumentatifs ordinaires, qu’elle analyse avec les instruments de la linguistique. Dix règles pour la discussion critique sont proposées. La Nouvelle…
On trouve dans la Rhétorique et les Topiques d’Aristote ainsi que dans la tradition qui en est issue de précieux instruments pour la recherche en argumentation – parfois plus adéquats que certaines définitions modernes. Mais les plans de la syntaxe et du texte restent les grands absents de ce paradigme. Cet ouvrage intègre ces deux niveaux à l’analyse du discours argumentatif à partir de l’examen du générique, de l’anaphore associative…
Présentes dès les origines de la réflexion philosophique et scientifique, les notions de catégorisation et de catégorie comme éléments de base de la pensée constituent un point nodal des recherches contemporaines en sciences cognitives. Les recherches psychologiques ont établi que les structures des connaissances en mémoire humaine ne peuvent se réduire à l’analyse traditionnelle des concepts. Ces données imposent de prendre en considération le rôle des systèmes symboliques et des…
Cet ouvrage propose une analyse du débat sur les parasciences tel qu’il se reproduit régulièrement dans les médias. Cette étude dévoile les stratégies discursives mises en œuvre par les débatteurs pour défendre leurs thèses ; construction d’une image de leur camp et de celui des opposants, invocation de précédents prestigieux, … Le Débat immobile s’inscrit dans le champ des recherches sur l’argumentation. Le travail qu’il présente fait appel aux outils…
A la croisée des études de presse et de l’analyse de discours, “l’immigration prise aux mots” repose sur une lecture minutieuse de dix journaux représentatifs des opinions politiques françaises et se propose de comprendre pourquoi, si différents les uns des autres en 1974, les discours tenus par les immigrés et l’immigration semblent se brouiller, s’entrecroiser et se recouvrir dans les années 1980. Ce livre permet d’appréhender comment la minorité extrême-droitière…
Prolongement et aménagement de la Théorie de l’argumentation dans la langue, la Théorie des topoï a fait l’objet de nombreuses publications. Une des motivations de cet ouvrage collectif a été de rendre cet outil de travail accessible à un plus vaste public de chercheurs et d’enseignants. On trouvera exposé ici un état de la question, à savoir : les fondements théoriques de l’argumentation dans la langue – quel type de…